Vic + Flo ont vu un ours
Surtout ne pas se fier au titre. Il a la légèreté d’annoncer une comédie décalée (ce qui n’est pas du tout le cas), voire une bluette enfantine (ce qui l’est encore moins), sans parler de la référence animale qui pourrait faire songer à une fiction animalière (n’y pensez même pas !).
Fausse piste
Vic et Flo est une tragédie, une vraie qui se passe au fond d’une érablière québécoise, dans et autour d’une cabane à sucre. Pour ceux qui l’ignorent, la cabane à sucre est un lieu de fête, très fréquentée au printemps quand on récolte la sève des érables pour en faire du sucre. Tout le monde y va, goûter au dernier crû, rouler des sucettes de sirop d’érable dans la neige, la fameuse « tire ». C’est une des traditions les plus vivaces du Québec et une des plus joyeuses, des plus familiales aussi.
 Rien de tout ça ici. Vic, pour Victoria, sort d’une longue peine de prison et se réfugie dans la cabane à sucre de son oncle. Elle compte y finir ses jours, isolée de tout et de tous. Enfin, de presque tous, puisque Florence (Romane Bohringer), sa compagne, vient l’y rejoindre. Les deux femmes sont différentes (Vic est plus âgée par exemple) mais elles partagent toutes les deux un lourd passé judiciaire.
Rien de tout ça ici. Vic, pour Victoria, sort d’une longue peine de prison et se réfugie dans la cabane à sucre de son oncle. Elle compte y finir ses jours, isolée de tout et de tous. Enfin, de presque tous, puisque Florence (Romane Bohringer), sa compagne, vient l’y rejoindre. Les deux femmes sont différentes (Vic est plus âgée par exemple) mais elles partagent toutes les deux un lourd passé judiciaire.
Faux espoirs
Vic pense pouvoir finir sa vie, ainsi, au calme, loin du monde et de la civilisation. Flo en est moins certaine, elle est plus instable aussi. Elle se verrait bien s’installer ailleurs.. Elles n’en auront pas le temps, car le passé va brutalement refaire surface.
 Quasi huis-clos forestier, Vic + Flo… reste un film inabouti. Il souffre des mêmes défauts que « Tirez la langue , Mademoiselle » d’Axelle Ropert qui sort aussi ce mercredi 4 septembre 2013. A force de ne vouloir rien révéler des personnages, de leur passé pour ne pas que le spectateur les juge, on se désintéresse totalement de leur sort. On comprend mal ce qui les unit autant (notamment pourquoi Florence reste auprès de Vic), pourquoi Vic se retrouve isolée, abandonnée de tous et incapable de s’occuper de son oncle, comment elles vivent…
Quasi huis-clos forestier, Vic + Flo… reste un film inabouti. Il souffre des mêmes défauts que « Tirez la langue , Mademoiselle » d’Axelle Ropert qui sort aussi ce mercredi 4 septembre 2013. A force de ne vouloir rien révéler des personnages, de leur passé pour ne pas que le spectateur les juge, on se désintéresse totalement de leur sort. On comprend mal ce qui les unit autant (notamment pourquoi Florence reste auprès de Vic), pourquoi Vic se retrouve isolée, abandonnée de tous et incapable de s’occuper de son oncle, comment elles vivent…
Faux rythme
Même l’échelle du temps n’est pas suffisamment maîtrisée pour qu’on accorde une quelconque crédibilité à cette histoire. On s’ennuie donc rapidement, alors que un portrait sensible de ces deux femmes fortes et faibles à la fois, mais à la langue bien pendue (ce qui était l’ambition de Denis Côté selon ses propres dires) méritait vraiment que l’on s’y attarde. Surtout que le trio d’acteurs (Pierrette Robitaille, Romane Bohringer, absente des écrans depuis longtemps, et Marc-André Grondin) fonctionne bien. Dommage même si le film a toutefois reçu l’ours d’argent au Festival de Berlin 2013.
De Denis Côté, avec Pierrette Robitaille, Romane Bohringer, Marc-André Grondin
2013 – Canada – 1h36
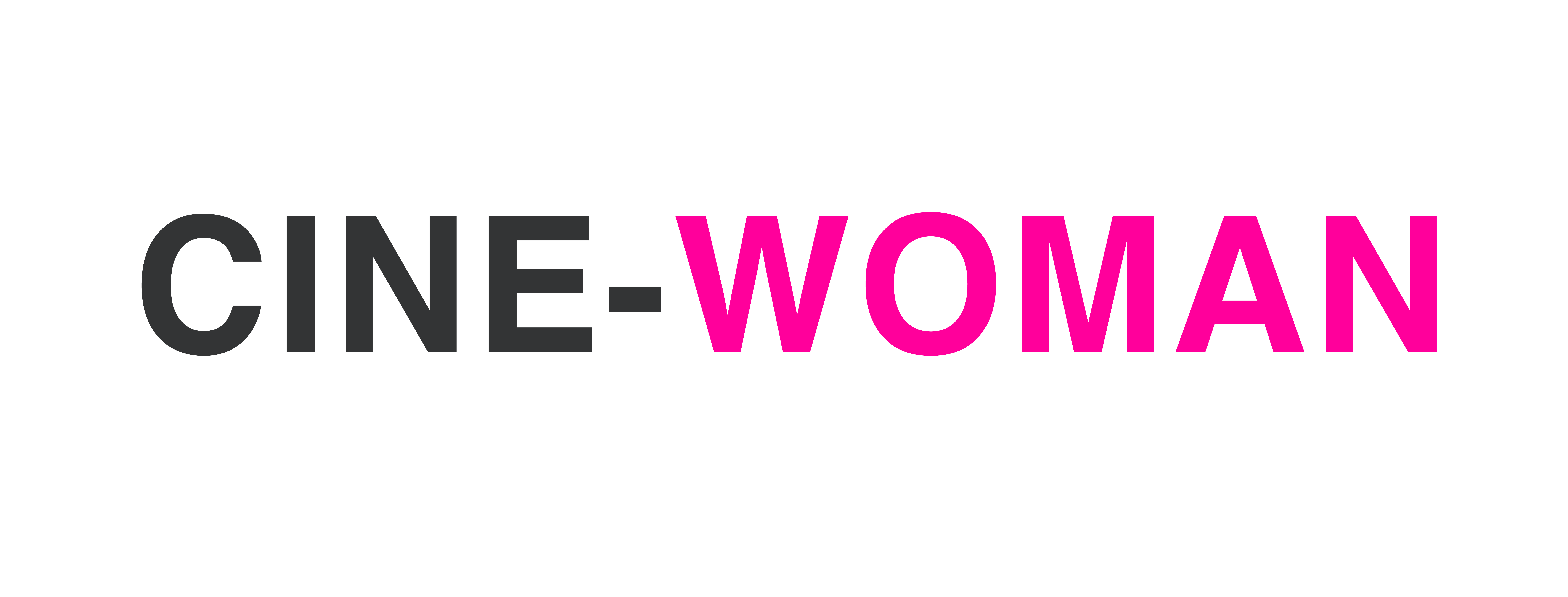


 On y découvre un pays en voie vers une démocratie où la discipline laisse peu de place aux libertés individuelles, où le respect des plus faibles ne va pas de soi, où l’argent et la réussite sociale sont les seules valeurs d’une classe moyenne ambitieuse, laborieuse mais peu considérée…
On y découvre un pays en voie vers une démocratie où la discipline laisse peu de place aux libertés individuelles, où le respect des plus faibles ne va pas de soi, où l’argent et la réussite sociale sont les seules valeurs d’une classe moyenne ambitieuse, laborieuse mais peu considérée… 


 Et puis, il y a Karole, la femme de Toni, un solide gaillard qui n’a peur de rien et surtout pas de s’approcher au plus près du cœur radioactif de la centrale. Gary, lui, préfère se frotter au cœur et au corps de Karole. Son amour le contamine aussi sûrement que les doses irradiantes qu’il prend tous les jours à la Centrale. Jusqu’à s’y perdre.
Et puis, il y a Karole, la femme de Toni, un solide gaillard qui n’a peur de rien et surtout pas de s’approcher au plus près du cœur radioactif de la centrale. Gary, lui, préfère se frotter au cœur et au corps de Karole. Son amour le contamine aussi sûrement que les doses irradiantes qu’il prend tous les jours à la Centrale. Jusqu’à s’y perdre.  Aux scènes de plongée au cœur des réacteurs nucléaires, succèdent des ébats champêtres dans la nature prolifique et rayonnante, entrecoupés par des moments collectifs partagés où la société reprend alors ses droits. Mais, qu’attendre justement de ces bonheurs furtifs quand la destruction s’annonce certaine? Rebecca Zlotowski y répond à la fois de manière touchante et sans illusion, jouant jusqu’au bout sur la dualité des sentiments et des situations. Passionnant.
Aux scènes de plongée au cœur des réacteurs nucléaires, succèdent des ébats champêtres dans la nature prolifique et rayonnante, entrecoupés par des moments collectifs partagés où la société reprend alors ses droits. Mais, qu’attendre justement de ces bonheurs furtifs quand la destruction s’annonce certaine? Rebecca Zlotowski y répond à la fois de manière touchante et sans illusion, jouant jusqu’au bout sur la dualité des sentiments et des situations. Passionnant.
 Soit donc une famille américaine moyenne, les Perron, qui décide dans les années 1970 de déménager dans une vieille ferme isolée du Rhode Island pour y élever tranquillement leurs cinq filles. Très vite, des phénomènes bizarres autant qu’étranges vont troubler ses nuits et bientôt ses jours. La maison semble hantée. Par chance, Carolyn Perron , la mère, assiste à une conférence des démonologues, Ed et Lorraine Warren, et parvient à les convaincre de venir faire un tour chez elle. ce qu’ils découvrent est terrifiant…
Soit donc une famille américaine moyenne, les Perron, qui décide dans les années 1970 de déménager dans une vieille ferme isolée du Rhode Island pour y élever tranquillement leurs cinq filles. Très vite, des phénomènes bizarres autant qu’étranges vont troubler ses nuits et bientôt ses jours. La maison semble hantée. Par chance, Carolyn Perron , la mère, assiste à une conférence des démonologues, Ed et Lorraine Warren, et parvient à les convaincre de venir faire un tour chez elle. ce qu’ils découvrent est terrifiant… L’autre point intéressant est justement que ce qui motive Lorraine Warren à résoudre ce cas difficile est justement la raison qui a poussé la famille Perron à s’installer dans cette maison. Si elle n’avait pas été une mère concernée, sans doute ne se serait-elle jamais impliquée dans cette énigme.
L’autre point intéressant est justement que ce qui motive Lorraine Warren à résoudre ce cas difficile est justement la raison qui a poussé la famille Perron à s’installer dans cette maison. Si elle n’avait pas été une mère concernée, sans doute ne se serait-elle jamais impliquée dans cette énigme.


 Passons sur les péripéties qu’elles traversent, sur l’histoire de leur vie respective, triste à pleurer évidemment, et surtout sur l’enquête qu’elles mènent ensemble et qui n’a aucun intérêt pour regretter les choix finalement tellement conventionnels de la part du réalisateur Paul Feig, celui qui s’était hasardé à tourner, « Mes meilleures amies », la soi-disant première comédie féminine… la première où les femmes osaient péter, roter et même dégueuler en pleine rue, sur une robe de mariée. Si faire du cinéma féminin, c’est forcément s’approprier la truculence masculine, merci bien !
Passons sur les péripéties qu’elles traversent, sur l’histoire de leur vie respective, triste à pleurer évidemment, et surtout sur l’enquête qu’elles mènent ensemble et qui n’a aucun intérêt pour regretter les choix finalement tellement conventionnels de la part du réalisateur Paul Feig, celui qui s’était hasardé à tourner, « Mes meilleures amies », la soi-disant première comédie féminine… la première où les femmes osaient péter, roter et même dégueuler en pleine rue, sur une robe de mariée. Si faire du cinéma féminin, c’est forcément s’approprier la truculence masculine, merci bien !
 Si le récit est, au départ, très maîtrisé, dominé par la figure imposante et idéale de Mads Mikkelsen, la seconde partie (la deuxième heure) est moins intéressante, plus ennuyante. Sans doute parce que la rectitude morale du héros, soudainement contestée, est moins défendue par le réalisateur lui-même… avant un final très fort, très émouvant.
Si le récit est, au départ, très maîtrisé, dominé par la figure imposante et idéale de Mads Mikkelsen, la seconde partie (la deuxième heure) est moins intéressante, plus ennuyante. Sans doute parce que la rectitude morale du héros, soudainement contestée, est moins défendue par le réalisateur lui-même… avant un final très fort, très émouvant.
 Vendu comme un hommage à l’Afrique, c’est en fait une sorte de méli-mélo culturel qui sonne parfois plus du coté des Caraïbes que de l’Afrique noire. Mise à part ces petites fautes de goût ou ces écarts à l’orthodoxie culturelle, les enfants adoreront cette sempiternelle histoire de relations père-fils, née sur des bases compliquées qui ont empêché un vrai épanouissement et du géniteur, et de la descendance. Mais tout finit par s’arranger bien sûr …
Vendu comme un hommage à l’Afrique, c’est en fait une sorte de méli-mélo culturel qui sonne parfois plus du coté des Caraïbes que de l’Afrique noire. Mise à part ces petites fautes de goût ou ces écarts à l’orthodoxie culturelle, les enfants adoreront cette sempiternelle histoire de relations père-fils, née sur des bases compliquées qui ont empêché un vrai épanouissement et du géniteur, et de la descendance. Mais tout finit par s’arranger bien sûr …
 A chaque fois, le principe est le même : les cafards sont les empêcheurs de tourner en rond, voire les méchants d’une histoire menée à un rythme d’enfer dans la plus pure tradition du cartoon à l’américaine. C’est –à-dire qu’il n’y a pas de paroles, seulement des bruitages et des gags visuels qui se succèdent à toute allure. Comme dans Tom et Jerry ou un dessin animé de Tex Avery.
A chaque fois, le principe est le même : les cafards sont les empêcheurs de tourner en rond, voire les méchants d’une histoire menée à un rythme d’enfer dans la plus pure tradition du cartoon à l’américaine. C’est –à-dire qu’il n’y a pas de paroles, seulement des bruitages et des gags visuels qui se succèdent à toute allure. Comme dans Tom et Jerry ou un dessin animé de Tex Avery.





