De la neige pour Noël
Dès 4 ans
Voilà un conte de Noël réjouissant qui nous vient directement de Norvège. A quelques jours du réveillon du 25 décembre, la petite ville de Pinchcliffe attend la neige avec impatience.
Dérèglement climatique
Les enfants veulent faire du ski, les adultes s’équiper en matériel, Solal essayer sa nouvelle luge, le lapin blanc se cacher etc… Et le directeur du journal local qui l’annonce depuis longtemps, l’attend encore plus que les autres !

L’ingénieux Feodor met alors au point un canon à neige ultra-puissant dont le journaliste s’empare. Mais, la machine s’emballe et Pinchcliffe court à la catastrophe. Y aura-t-il trop de neige à Noël ?
Drôle et instructif
Inspiré par l’univers de Kjell Aukrust, célèbre illustrateur norvégien, cette aventure de Noël, très riche en rebondissements, offre, pour une fois, une belle histoire originale et décalée aux enfants.

Drôle, dynamique, reposant sur des personnages bien typés et sur des gags très rigolos, ce film plein d’entrain et de chaleur, est la nouvelle réalisation de Rasmus A. Siverten. On lui devait déjà les aventures de Ploddy, la voiture électrique mène l’enquête. Là encore, le cinéaste aborde un sujet qui lui tient à cœur – le dérèglement climatique- et en profite pour sensibiliser tout en les amusant les plus jeunes à l’écologie. Bien fait !
De Rasmus A. Siverten.
2013 – Norvège – 1 h 16
En partenariat avec Grains de Sel
Cine-woman vous offre des places pour aller voir ce chouette dessin animé. Envoyez vos coordonnées à vlebris@cinewomapx.cluster026.hosting.ovh.net
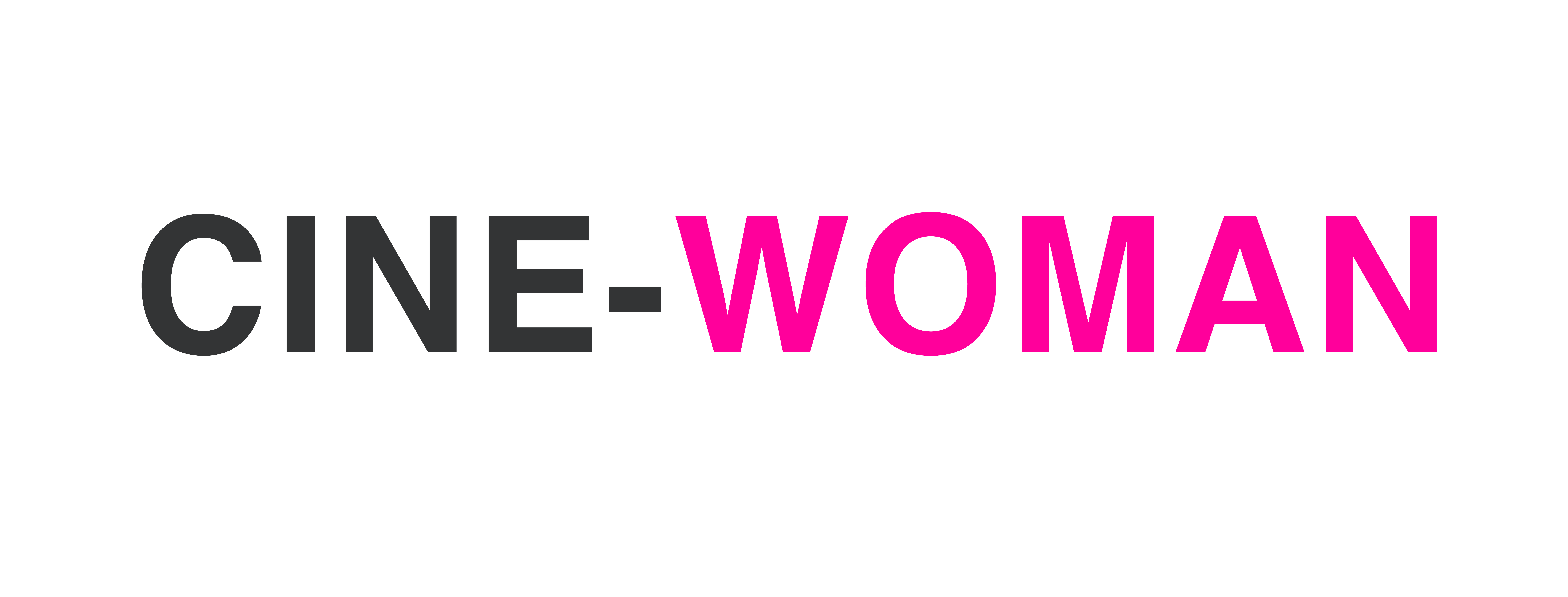




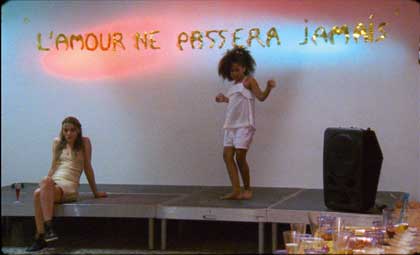

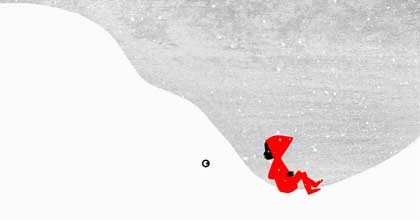


















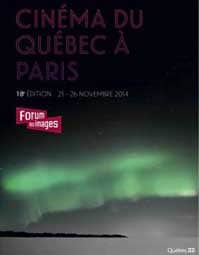 Après la tornade
Après la tornade 
















